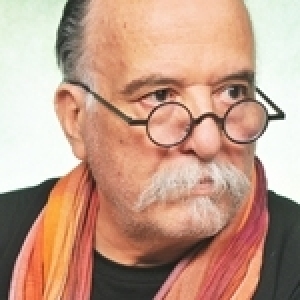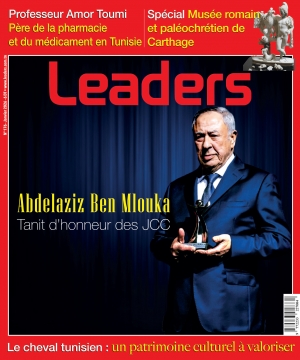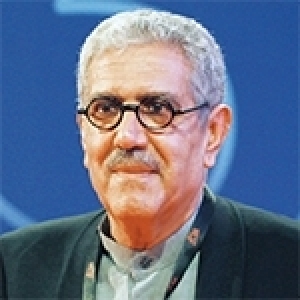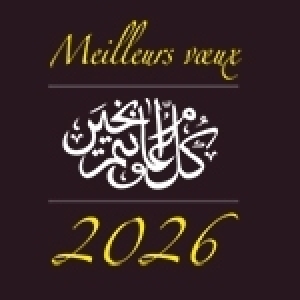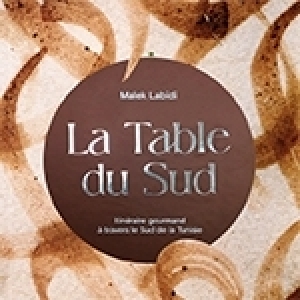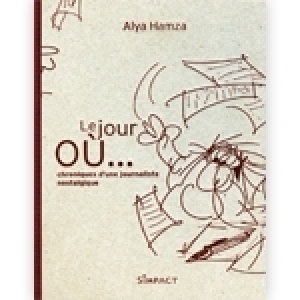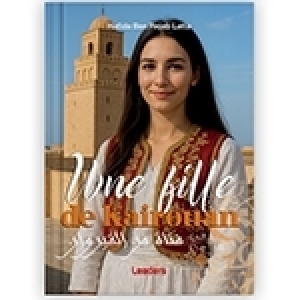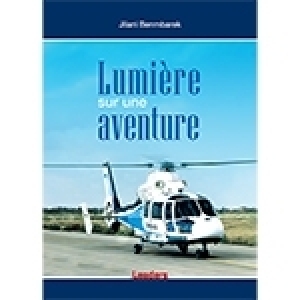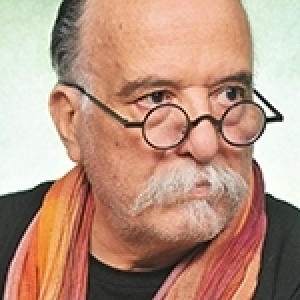Habib Batis: La «liberté de l’esprit» à l’ère du numérique
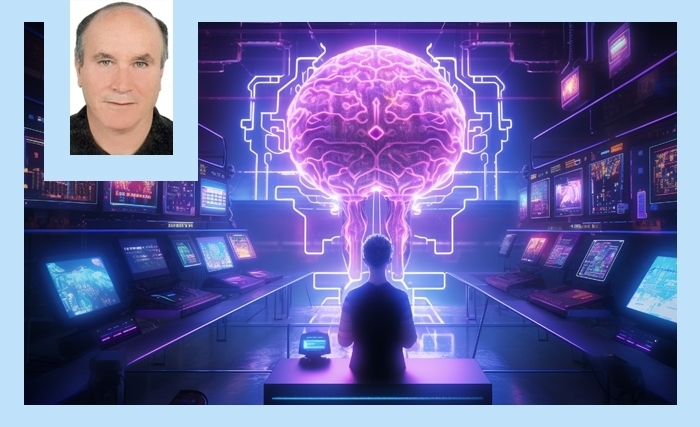
Depuis plus d’un demi-siècle, la course aux innovations technologiques ne cesse de s’accélérer et avec elle les technologies numériques qui ont désormais envahi toutes les sphères de l’existence. Ce processus télé technologique se poursuit imperturbablement à mesure que les conditions de vie sur la biosphère se détériorent progressivement. En effet, pendant que les rapports des organismes internationaux alertent sur les périls du chao climatique et de la crise écologique de plus en plus apocalyptique, l’univers numérique apparait comme un refuge fantasmatique. Cette apocalypse scientifiquement annoncée et qui fait les titres des actualités quasi-quotidiennement, semble se télescoper avec l’avènement du règne de l’entreprise numérique. Cette dernière entend désormais se lancer dans le champ de la dite réalité virtuelle pour prendre le contrôle des environnements numériques immersifs. L’implication ou l’engagement de l’utilisateur dans cette expérience l’emmène à ne plus faire attention au temps qui s’écoule et à oublier l’environnement physique dans lequel il se trouve.
C’est dire que ce renouveau technologique est inarrêtable. Nous n’avons pas encore pris la pleine mesure d’un tel bouleversement dans une époque écartelée entre l’idéologie du progrès technologique et la réalité de la crise écologique. Des plus technophiles aux plus techno-rétifs, rares sont ceux qui ne s’inquiètent pas des conséquences sur l’organisation du travail, l’éducation, les relations sociales ou sur la surconsommation des écrans chez les jeunes générations. On peut même se demander si les créateurs du modèle industriel mis en place à travers ces dispositifs numériques, maîtrisent ses travers et ses impacts, même si certains entrepreneurs repentis s’inquiètent de la nocivité des dispositifs qu’ils ont produits et déplorent les effets des réseaux sur le cerveau.
L’environnement numérique et la dispersion de l’esprit
Récemment on a vu paraitre deux publications symptomatiques du tiraillement entre deux points de vue opposés sur le développement fulgurant des technologies numériques, et en particulier de ce qui est appelé «intelligence artificielle». Le premier ouvrage (Quand la machine apprend. La révolution des neurones artificiels et de l’apprentissage profond. Y. Le Cun. 2019) vante les progrès de l’apprentissage automatique par les systèmes d’ «intelligence artificielle» fondés sur les systèmes neuronaux. Le second (La fabrique du crétin digital. Les dangers des écrans pour nos enfants. M. Desmurget. 2019) dénonce l’entreprise de décérébration des jeunes générations par la surconsommation d’écrans. Une jeunesse qui ne semble exister au monde qu’à travers ses interactions numériques au regard notamment de la diversité et de l’intensité des usages qu’on peut aisément constater.
Ce phénomène, désigné aussi par «schizophrénie numérique» (Schizophrénie numérique. La crise de l’esprit à l’ère des nouvelles technologies. Anne Alombert 2023), apparait plus généralement à travers deux discours opposés. Cette «schizophrénie» laisse entendre un dilemme existentiel dans notre relation avec les nouvelles technologies. Elle décrit aussi une dislocation de l’esprit caractérisée par une tension entre ces deux discours. D’un côté, les discours transhumanistes qui font l’éloge des progrès technologiques portés par les grandes entreprises du numérique. Discours qui s’accompagnent souvent d’une anthropomorphisation des machines à travers des expressions comme «intelligence artificielle», «apprentissage automatique», «agent conversationnel», etc. De l’autre, des discours portés par des études scientifiques, témoignent des dangers que les médias numériques peuvent engendrer pour nos capacités psychiques, mentales et intellectuelles.
L’environnement numérique, la surabondance informationnelle et la « liberté de l’esprit »
En dépit des possibilités d’omniscience et d’ubiquité qu’elles pourraient concrétiser, l’exagération des objets connectés provoquant par ailleurs une surcharge informationnelle souvent incohérente, soumet les esprits à une agitation et une nervosité généralisées. Le risque est grand pour mettre en péril «la liberté de l’esprit». Pour son activité, cette dernière exige son propre rythme. Elle s’oppose à toutes ces sensations incohérentes ou violentes qui nous acculent à ne vivre que par à-coups et dans le présent. Cette liberté se voit donc perturbée par les secousses incessantes des actualités ou par l’éclatement des facultés de sentir et de penser. Bref, nous vivons en temps réel, un monde d’information organisé de sorte qu’on est enclin à ne plus savoir quoi en penser.
Ce phénomène d’hyperconnexion se combine aussi à un phénomène d’individualisation et de dislocation où on voit en temps réel l’effilochement des liens sociaux où chacun est dispersé dans un endroit différent n’ayant pour seul vis-à-vis que ce que la machine lui envoie comme représentation d’elle-même. Or la liberté en général, et, celle de l’esprit en particulier ne se définit que par référence à la construction de chacun par lui-même avec l’aide des autres. Elle est la possibilité de tisser des liens avec ceux qui nous entourent. Elle n’est donc pas un exercice solitaire quoique l’environnement numérique incite à le penser. Par ailleurs, cette liberté n’est jamais définitivement acquise; elle n’est pas une conquête qu’il suffit de défendre. Il faut en permanence la définir, la mettre en place, l’adapter au monde qui change à l’ère du numérique.
Ce bref regard sur l’impact du numérique doit aussi nous interpeler, désormais, à travers toutes sortes de psychopathologies, depuis les troubles de déficits attentionnels qui touchent particulièrement les plus jeunes générations jusqu’au syndrome de saturation cognitive dont les cadres disent souffrir. Cette situation où prédominent l’hyperconnexion et l’infobésité conduit à l’ «ère de la post-vérité»: une situation où la crédibilité des discours repose moins sur leur correspondance avec la réalité que sur leur résonnance avec les croyances des individus (https://www.leaders.com.tn/article/36794-les-reseaux-sociaux-et-le-trop-plein-d-information-eprouver-les-certitudes). Elle autorise une mise en parallèle avec l’infodémie, terme utilisé par l’OMS en 2020 pour désigner un facteur d’aggravation de la pandémie du Covid-19: la propagation du virus dans les organismes et les sociétés était alors corrélée à la propagation d’informations fausses dans les milieux connectés.
Par-delà le vocable «d’intelligence artificielle»
Nous baignons dans un univers numérique. Sans pour autant rester à l’écart, nous gobons à notre insu, des glissements sémantiques et des zones d’ombre qui devraient nous alerter. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’interfaces numériques et de calculs statistiques, la machine a été programmée pour utiliser le pronom «je» dans la réponse de ChatGPT: «je ne suis pas un humain». Ceci devrait nous interpeler, car l’utilisation du «je» ne laisse-t-elle pas présupposer un sujet? En dépit de la prétendue transparence de la machine, cette utilisation ne camoufle-t-elle pas l’opacité d’un brassage, une combinatoire d’une énorme quantité de données produites par les humains eux-mêmes et traitées par des algorithmes qui lui permettent de fonctionner?
C’est-dire qu’il n’y a rien là de créatif et d’intelligent. Un algorithme qui calcule n’est pas une pensée incarnée, affective et interprétative. En réalité, tout est fait pour qu’on suive tête basse le slogan et pire qu’on oublie l’essentiel: on ne sait pas comment les choix du fonctionnement sont opérés, ni les manières dont procède la combinatoire. Bref, on est à des millénaires de ce qui devrait être transparent et même démocratique.
De plus, il ne faut pas perdre de vue que, ce qui est appelé «intelligence artificielle» émerge à une époque où le paradigme de marchandisation est dominant : marchandisation de la santé, de l’éducation, de la culture…Or, qui dit marchandisation dit contrôle et appropriation, donc une prise de pouvoir sur les êtres et le temps. C’est une opération par laquelle toute entité se retrouve réduite à un stock envisagé selon les bénéfices que son exploitation pourrait engendrer. Au sein de ce paradigme surgit désormais la possibilité de saisir les êtres humains comme des stocks de données auxquels il est possible d’appliquer des calculs statistiques pour les assujettir à des recommandations automatiques de produits consommables. Le temps d’utilisation des objets connectés devient alors convertible en une marchandise qui alimente, par le biais de la probabilité de comportement, les entreprises publicitaires. Et dans le contexte actuel du numérique, il faut entendre par marchandisation, la soumission des savoirs (faire, penser, théoriques et pratiques) à des dispositifs de calcul, d’extraction, de stockage, d’accumulation et d’exploitation pour les transformer en ressources exploitables et capitalisables. Le but est unique : assimiler ces savoirs à un capital à fructifier à l’instar de la santé et de l’éducation.
Il se dégage de cette stratégie que, l’organisation actuelle que posent les entreprises productrices et gestionnaires de l’environnement numérique que nous utilisons, se fixe comme objectif l’automatisation, l’uniformisation mimétique de nos conduites et de nos esprits. Une manière efficace pour les rendre prédictibles et donc assoir une recherche d’une rentabilité projetée. Conséquence, en tant qu’usagers, nous perdons la possibilité de nous détacher du commun et de l’habituel qui caractérise la «liberté de l’esprit». Une liberté censée nous permettre d’aller chercher l’improbable qui passe sous les radars des lois statistiques. On peut alors se demander si, à l’instar des effets délétères du taylorisme, on ne subit pas des effets de ce que Stiegler appelle «la prolétarisation» généralisée des processus d’automatisation. Il est probable, et on commence à le voir en temps réel, que derrière le vocable « intelligence artificielle », la machine génère en réalité, une prolétarisation similaire. En effet, le risque est grand pour que les produits «humanisés» générés par la machine et livrés à l’utilisateur, réduisent et menacent nos facultés de compréhension, d’imagination, de mémorisation et même nos capacités herméneutiques. Le monde se trouve alors glacé dans les logiques et biais dominants au détriment de l’initiative politique dont l’objet est justement la contradiction.
Un environnement numérique alternatif, est-ce possible?
La situation d’enfermement qui prévaut et se propage actuellement incite à la recherche d’une voie de sortie qui dépasse le transhumanisme. Celui-ci identifie le cerveau à l’ordinateur et réduit l’esprit à des calculs statistiques sur un stock de données. Le problème est moins celui de ce qui est appelé «intelligence artificielle» qui, à proprement parlé est un leurre, que celui de l’automatisation des conduites et l’assujettissement de l’esprit à ces calculs conduisant à une prolétarisation mortifère. La situation impose de chercher à proposer autre chose qui puisse sortir nos esprits de cette ghettoïsation pour les faire communiquer. Certes, la tâche s’annonce tellement difficile qu’on n’est plus d’accord sur ce que c’est que le réel et donc on éprouve de plus en plus de difficultés sur le comment se projeter dans l’avenir. Comment peut-on alors convoquer notre intelligence collective vu que le coût de l’inaction risque d’être plus important que celui de l’action?
Il s’agit aussi de ne pas tomber dans les travers d’une opposition caricaturale et classique entre l’humain et la machine. Bien au contraire, l’esprit, cette partie incorporelle de l’être humain, ne se loge ni dans son cerveau ni dans ses neurones, mais partagée entre les semblables et les générations par le biais de milieux à la fois techniques, symboliques et sociaux. L’importance est donc de taille pour ne pas abandonner le terrain du numérique à l’hégémonie privative faisant du savoir humain une simple marchandise à capitaliser. Plutôt faire du numérique une question politique. En ce sens, il est nécessaire de transformer les technologies qui contrôlent nos cerveaux connectés et nous individualisent pour ériger des technologies de communication des esprits et de culture de l’intelligence collective. Celle-ci est le tremplin de la communication, de la créativité, du partage des ressources et des savoirs et de la diversité des modes de pensée. Elle est aussi le moyen de désautomatisation des comportements et une voie de sortie des avatars de l’uniformisation et de la pensée unique que peut infliger l’isolement avec la machine à nos cerveaux.
Bref, plusieurs secteurs de notre société peuvent faire en sorte que le numérique renoue avec des pratiques où les acteurs de ce secteur interagissent directement les uns avec les autres sans passer par un réseau centralisé. C’est ainsi que chacun peut agir comme fournisseur et consommateur de ressources pour créer un réseau décentralisé et résistant. Les acteurs du secteur de l’éducation sont vraisemblablement les mieux placés pour mettre l’intelligence de chacun au service de la communauté. Une voie permettant d’articuler automatisation et autonomie, travail et numérique, démocratie et culture interprétative à l’heure du tout calculable. Il est possible de façonner un modèle où les technologies numériques servent l’intelligence collective par la mise en commun et l’apport de chacun. Car, le mécanisme de partage des savoirs contribue à accroitre leur valeur et se place donc en porte-à-faux du paradigme de la marchandisation où, au contraire, la rareté est synonyme de valeur. C’est aussi une opportunité pour ce secteur pour intégrer, dans les formations interdisciplinaires, celle dévouée à l’éducation à l’environnement numérique (EEN) à l’instar de l’éducation à l’environnement (EE) et l’éducation à la santé (ES). Un moyen pour amener les apprenants de toute discipline à appréhender le risque que le travail qu’ils entreprennent par une utilisation aveugle de l’environnement numérique, ne devienne une suite de tâches basiques dont la finalité n’est plus de fournir consciemment une production qui exprime leur créativité et leur singularité, mais d’entraîner les larges modèles de langage qui sont au cœur des mécaniques qu’on nomme, à tort, «intelligence artificielle».
Habib Batis
- Ecrire un commentaire
- Commenter