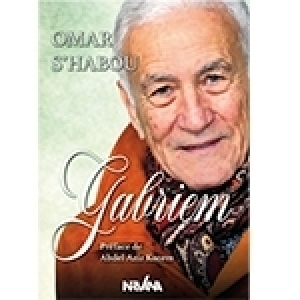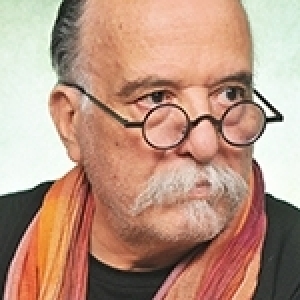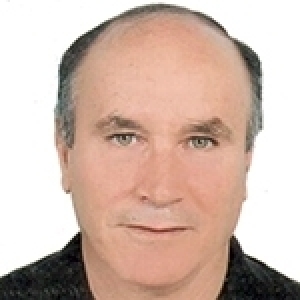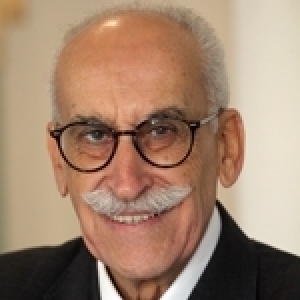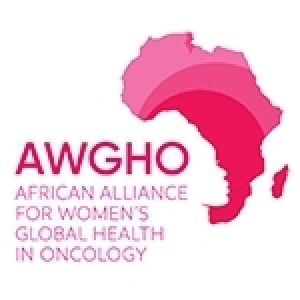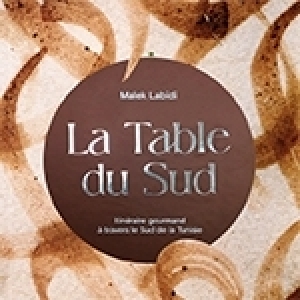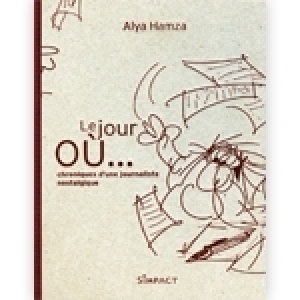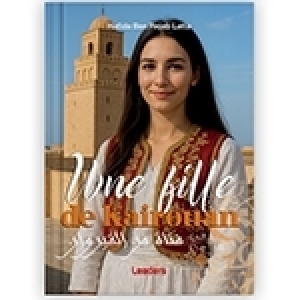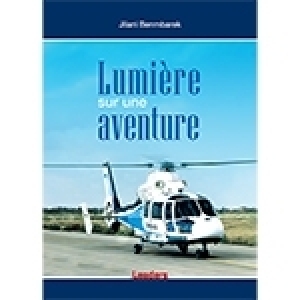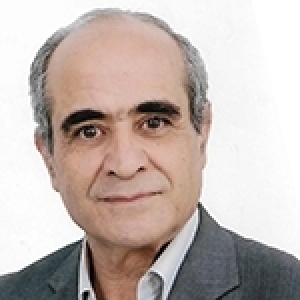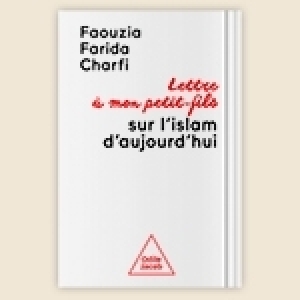Riadh Zghal: L’appropriation de la technologie et la demande sociale pour la science

Si l’on examine l’émergence de pays comme la Chine, seconde puissance économique mondiale, et d’autres pays qui ont créé suffisamment de richesse pour sortir des millions de citoyens de la pauvreté, il paraît évident que les principaux leviers de leur émergence ont été la science, l’appropriation et l’innovation technologique. L’appropriation de la technologie débute par un rapport intelligent à une technologie importée que l’on adapte à des besoins, un contexte faits de moyens humains et matériels. Elle se poursuit par des innovations nécessaires à l’adaptation au contexte, depuis la maintenance des équipements en passant par l’innovation dans les produits et les services jusqu’à arriver à investir dans une politique de recherche et développement R&D puis s’adresser aux universités et centres de recherche spécialisés dans la recherche fondamentale et formant aux exigences d’une économie de la connaissance.
Depuis son indépendance, notre pays a investi fortement dans l’éducation de ses enfants, le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a permis d’atteindre un niveau de maîtrise scientifique et technologique non négligeable qui a soutenu son industrialisation. L’émergence de startups technologiques créées par des jeunes sortant d’universités tunisiennes et étrangères a poussé l’Etat à promulguer en avril 2018 une loi visant à stimuler davantage de création de telles entreprises puis un décret créant un label startup. Néanmoins, le Système national d’innovation (SNI) laisse encore à désirer et ne permet pas de hisser le pays à un rang comparable à celui de la Corée du Sud, Singapour et autres pays qui ont réussi à sortir de la catégorie «tiers monde».
Le moment est venu aujourd’hui pour s’interroger et surtout apporter des réponses à tant de dysfonctionnements qui minent l’exploitation performante de tant de potentialités dont dispose notre pays pour la création de richesse. Un pan du capital humain national fait de personnes qualifiées et hautement qualifiées, formées par nos universités, se perd par l’émigration: ingénieurs, médecins, universitaires, techniciens paramédicaux et autres, même des startupeurs, plus généralement ceux dont on a le plus besoin pour entrer de plain-pied dans l’économie de la connaissance qui domine le monde prospère. Le secteur privé investit peu dans la R&D et l’environnement de recherche semble inadapté pour retenir les compétences et stimuler la coopération université-secteur productif. Les gouvernements successifs depuis 2015 n’ont pas réussi à pousser l’Union européenne à aller jusqu’au bout de la logique des accords pour « la création d’une zone de prospérité commune » en contribuant au renforcement du système national de science et de technologie comme elle l’a fait par le programme de mise à niveau des entreprises pour les aider à accéder au marché européen. Cela n’était pas étranger à la conscience de certains responsables européens. Manfredo Fanti, alors chef de délégation de la Commission européenne à Tunis, affirmait dans une interview au Dossier Spécial Euromed du 16 juillet 2002 : «Le problème de la diversification des exportations se pose en termes de création par la puissance publique, des conditions d’émergence d’une économie du savoir qui soit authentiquement innovatrice…Les questions de l’innovation, de la nécessaire diversification de la base productive et de sa compétitivité extérieure ne sont d’ailleurs pas dissociables de celle de l’attraction d’IDE de qualité.» Dans le cadre d’une «politique de voisinage avec l’Europe», il aurait fallu instituer une politique volontariste de coopération en matière de science et technologie (ST) ouvrant de nouvelles perspectives qui tiennent compte des besoins de la Tunisie pour développer une économie de la connaissance favorable à la prospérité durable et inclusive.
Si le développement économique inclusif doit passer par la formation d’une économie de la connaissance et l’exploitation optimale des technologies, il y aura deux facteurs au moins à considérer. D’abord, l’usage optimal de la technologie n’est pas une question purement technique, elle est aussi et surtout une question humaine et de gestion. Le temps est révolu où l’on voyait dans la technologie un outil stable. Une fois acquis, il servira l’intérêt de son propriétaire. Or au fur et à mesure que les technologies évoluent vers plus de complexité, cela a produit de nouveaux facteurs impactant leur exploitation : les qualifications des utilisateurs et leur engagement envers les objectifs visés par les décideurs. Cela implique la révision des modes de gestion des ressources humaines dans les organisations, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’institutions. Dans le cas des nouvelles technologies qui fonctionnent au moyen de logiciels sophistiqués et d’intelligence artificielle parfois, c’est l’ensemble du système de gestion qui est exposé à des changements profonds. Certaines entreprises dans le besoin de compétences hautement qualifiées recourent à l’externalisation de certaines activités néanmoins stratégiques. D’autres créent une filiale qui groupe les spécialistes de leur système d’information gérés selon un cadre réglementaire différent de celui de la maison mère afin de pouvoir recruter et retenir cette catégorie de collaborateurs objet d’une forte concurrence au niveau national et international.
Le second facteur à considérer pour orienter l’économie nationale vers une économie de la connaissance est celui de la demande sociale pour la science qui rejaillit sur la prédisposition des décideurs à considérer dans leurs choix les résultats de la recherche scientifique. Cela pourrait renforcer la légitimité des politiques et des gouvernants car comme l’écrivait Jean-Jacques Salomon :"Le sous-développement extrême est précisément l'état qui ne crée aucune pression dans le milieu social en faveur de la recherche scientifique et technique." L'investissement dans l’éducation et la formation à lui seul ne produit pas nécessairement les retombées économiques et sociales attendues s’il n’y a pas une demande sociale pour la science et la technologie et si la gouvernance des entreprises, des institutions sociales et gouvernementales n’est pas en mesure d'exploiter les potentialités du capital intellectuel et technologique disponibles ni de tirer parti des résultats probants de la recherche scientifique réalisée dans le pays, particulièrement dans le domaine des sciences sociales.
L’intérêt pour la science et la valorisation du capital intellectuel sont une affaire d’acteurs sociaux, d’institutions, de culture, bref de société. Lorsque l’éducation et la recherche évoluent dans un environnement de désintérêt pour le savoir et son exploitation pour l’intérêt général, la voie s’ouvre à ces dérives que sont ces attitudes: par l’éducation, on vise le diplôme et par la recherche on vise l’ascension dans l’échelle professionnelle. Par contre, lorsque l’intérêt pour la science est présent dans la société et la sphère dirigeante que ce soit dans les entreprises et les institutions de l’Etat, on devient attentif aux innovations dans tous les domaines, on les scrute, les valorise, les diffuse, les documente car la connaissance se forme par l’accumulation, on les traduit en moyens pour améliorer la gouvernance, on les transforme en technologies nouvelles pour se positionner dans des niches assurant à l’entreprise et à l’économie nationale un avantage compétitif. Engels avait écrit : "Si la société a des besoins techniques, ceux-ci feront plus progresser la science que dix universités."
Si l'on admet que la science et la technologie se développent selon une demande sociale et politique, on comprend aisément pourquoi dans l'histoire, ce sont les époques d'essor civilisationnel qui ont connu le plus d'inventions et l'émergence d'un statut privilégié du savant. La science, produit social, répondant à une demande sociale, est influencée par la structure de la société, ses valeurs, ses processus de fonctionnement social, économique et politique. La science peut constituer un moteur d'évolution et de changements sociaux mais sa production dépend entre autres d'un facteur normatif. C'est celui de l'appréciation de la société par elle-même, autrement dit la croyance en ses propres capacités auto-évolutives et créatives ou, au contraire, sa perpétuelle dépendance de l'emprunt culturel et du transfert de la science et de la technologie en provenance de sociétés plus avancées.
Riadh Zghal
- Ecrire un commentaire
- Commenter