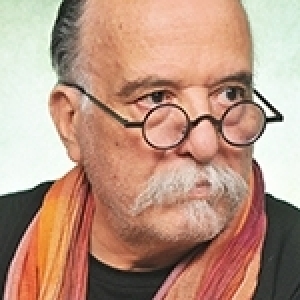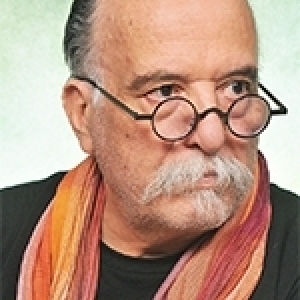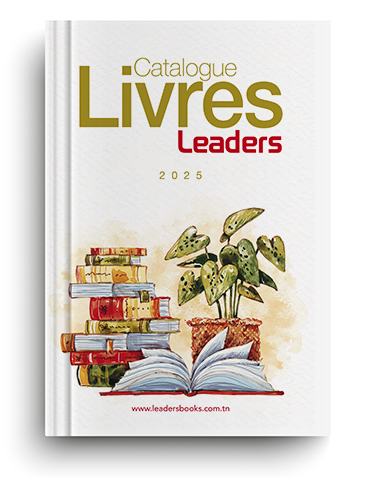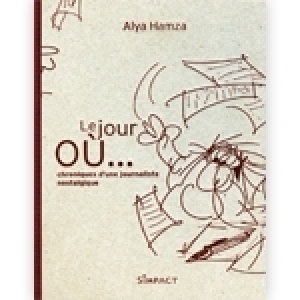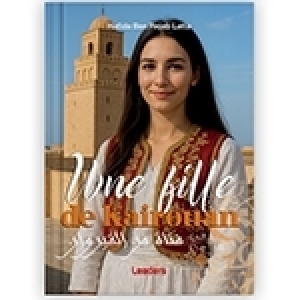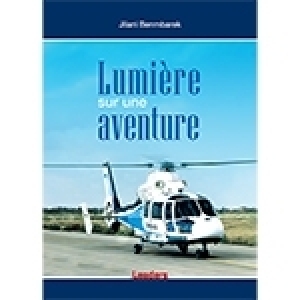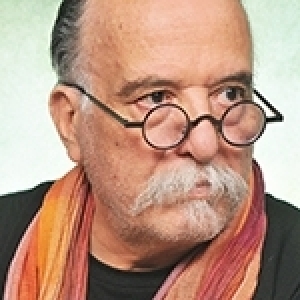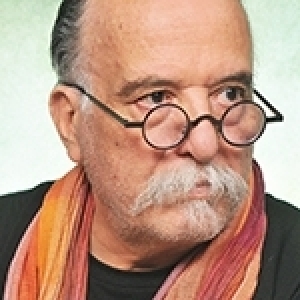Opinions - 09.02.2014
Monia Ben Jémia: Y a-t-il du nouveau en matière d'ordre public international ?
L’ordre public international intervient pour écarter les normes (lois et décisions) étrangères contraires aux choix fondamentaux de l’ordre juridique tunisien (articles 36 et 11 du Code de droit international privé tunisien). Ces choix sont plus précisément les principes que le juge induit de la loi, puise dans les conventions internationales régulièrement ratifiées par l’Etat tunisien et dans la constitution, étant entendu que les principes induits de la loi doivent être conformes à ces derniers textes, placés au sommet de la hiérarchie juridique.
Le passage d’un régime totalitaire à un état de droit, pose la question de la légalité et de la légitimité du droit posé antérieurement à la transition. La constitution de 1959 abrogée, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme deviennent la norme fondamentale et c’est à leur lumière que les lois en vigueur doivent être interprétées. Un Etat de droit est en effet un régime qui protège les droits de l’homme, conformément à la DUDH et au PIDCP. Plus précisément, l’ONU définit l’état de droit comme étant « un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’Etat lui-même, ont à répondre de l’observation des lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante et compatible avec les règles et normes internationales en matière de droit de l’homme »
Le juge qui donne son contenu à l’ordre public familial international, auquel je me limiterais, doit donc induire des dispositions du code du statut personnel, les principes qu’il pourra opposer à la norme étrangère et dont la validité dépendra de leur degré de conformité aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme.
C’est ce que proclame un arrêt rendu par la Cour d’appel de Tunis, le 5/2/2013 (référé n°43429, inédit) à propos de la question de la liberté de circulation internationale et du droit à un passeport « la constitution de 1959 reste en vigueur dans ses dispositions garantissant les droits et libertés fondamentaux car ceux-ci, en raison de leur nature, ne peuvent être abrogés et ce, conformément au PIDCP de 1966, ratifié par la Tunisie dans la loi n°30 du 20 novembre 1968 »
Cet arrêt place ainsi les droits humains fondamentaux au sommet de la hiérarchie des normes et en fait la source formelle unique auquel le juge est autorisé à se référer pour interpréter la loi. L’ordre public dont la fonction est de protéger les choix fondamentaux de l’ordre juridique tunisien ne pourra être nourri que de ceux-ci. Même si cet arrêt ne concerne pas le statut personnel, le principe qu’il pose est applicable dans tous les domaines, y compris le droit de la famille, d’autant qu’il est conforme aux standards internationaux régissant les transitions politiques et plus précisément la justice transitionnelle.
La nouvelle constitution adoptée le 26 janvier 2014, reprend sa place de norme fondamentale, les principes induits du code du statut personnel doivent lui être conformes, et même s’ils peuvent être puisés dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, ceux-ci ont une valeur inférieure à la constitution conformément à son article 20.
Quand on examine la jurisprudence antérieure, les principes fondamentaux qui avaient été invoqués lors de la mise en œuvre de l’ordre public familial international sont l’égalité entre les hommes et les femmes, celui de la liberté de conscience et de l’intérêt de l’enfant.
Si le premier faisait l’unanimité et avait permis d’écarter des normes étrangères inégalitaires telles la polygamie et la répudiation, on ne peut en dire autant pour le second. Mais les dernières décisions en date annonçaient la consolidation de la liberté de conscience par son érection en « pilier » de l’ordre juridique tunisien. Quant au troisième principe, l’intérêt de l’enfant, il n’a pu éclore et s’épanouir qu’avec la consolidation des deux premiers
L’unification du contenu de l’ordre public autour des droits de l’homme est elle en voie de se réaliser ? C’est à cette question que je tâcherais de répondre en examinant en premier lieu l’état de la jurisprudence durant la période transitoire précédant l’adoption de la constitution (I), et en second lieu le contenu des dispositions de la constitution du 26 janvier 2014 susceptibles de nourrir l’ordre public familial international (II)
Ordre public familial international et droits de l’homme avant l’adoption de la constitution du 26 janvier 2014
Il n’y a dans le code du statut personnel aucune discrimination d’ordre religieux. A l’indépendance, la justice et la loi avaient été unifiées par l’abolition des tribunaux religieux compétents en matière de statut personnel et, une fois le code promulgué, il devint applicable pour tous les tunisiens quelle que soit leur confession. L’état civil ne contient par ailleurs aucune indication de l’appartenance religieuse des tunisiens dont la nationalité est attribuée sans référence à celle ci. Le seul critère de rattachement est la nationalité, à l’exclusion de l’appartenance religieuse.
Mais des discriminations d’ordre religieux avaient été établis par la jurisprudence et l’administration, par référence à l’article premier de la constitution de 1959 qui disposait : « La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la République ». Le mariage de la tunisienne musulmane avec un étranger non musulman est alors interdit par voie de circulaire (1975) adressée aux officiers d’état civil et à la justice, demandant aux uns de refuser de célébrer un tel mariage si l’époux ne se convertit pas préalablement à la religion musulmane, aux autres de l’annuler en cas d’absence de respect de cette condition. Conclu à l’étranger en dépit de cette interdiction, il n’était pas reconnu en Tunisie. L’adoption par un étranger non musulman d’un tunisien musulman était également interdite et, faite à l’étranger, elle n’était pas reconnue en Tunisie. L’étranger non musulman n’héritait pas du tunisien musulman ; enfin, les juges refusaient de reconnaître les décisions étrangères accordant la garde à la mère étrangère et/ou domiciliée à l’étranger d’enfants nés d’un père tunisien, pour des motifs d’ordre religieux, principalement.
Mais à partir de la fin de la fin des années 90, un autre courant jurisprudentiel voit le jour à l’antipode de celui-ci et refuse l’ensemble de ces discriminations religieuses, en se basant sur les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux articles 5 et 6 de la constitution de 1959 garantissant respectivement la liberté de conscience (du moins dans sa version française) et l’égalité des citoyens. Cette jurisprudence avait fait de la liberté de conscience un choix fondamental de l’ordre juridique tunisien. Et avait utilisé outre les arguments puisés dans l’unification du code du statut personnel, l’impossibilité de prouver la religion des individus et l’interdiction de s’immiscer dans leur conscience. Monsieur Ali Mezghani avait alors souligné la « laïcisation » de l’ordre public et s’était interrogé sur le point de savoir si au-delà d’une évolution notable de la jurisprudence, il ne s’agissait pas là d’un véritable revirement, d’une révolution.
Cette jurisprudence ne faisait certes pas l’unanimité, d’autres juges maintenaient ces discriminations. Mais ils étaient de plus en plus minoritaires. Et même si certains continuaient à puiser dans le référent religieux, ils en faisaient une interprétation plus libérale. Ainsi par exemple, s’ils continuaient à puiser dans le fiqh la règle selon laquelle la disparité de religion est un empêchement à l’héritage, ils avaient permis aux gens du livre (juifs et chrétiens) d’hériter d’un musulman. Si les adoptions internationales continuaient à être interdites, ce n’était plus pour un motif religieux (du moins celui-ci n’était pas affiché), mais pour des raisons tenant à l’intérêt de l’enfant et à la crainte que celui-ci ne fasse l’objet de traite internationale d’êtres humains (La Tunisie a ratifié le protocole additionnel en 2002). Peu à peu, la liberté de conscience était reconnue, elle s’érigeait de manière progressive en choix fondamental de l’ordre juridique tunisien, l’intérêt de l’enfant devient désormais la mesure en matière d’adoption. Mais aussi de garde, on reconnait les décisions étrangères accordant la garde aux mères étrangères domiciliées à l’étranger d’enfants nés de pères tunisiens sans égard au facteur religieux, au vu du seul intérêt de l’enfant.
La Tunisie a connu de multiples crises, lors de cette transition. Aux crises politiques, sécuritaires, économiques et sociales, s’est ajoutée une crise institutionnelle, notamment au niveau de la justice et des instances chargées de la publication des décisions judiciaires. Avant la transition, nous avions ce précieux commentaire du Code de droit international privé, effectué par Messieurs Malek Ghazouani et Lotfi Chadli publié par le centre d’études juridiques et judiciaires du ministère de la justice en 2008, dans lequel avaient notamment été publiés les attendus principaux des décisions rendues, y compris celles inédites.
Je n’ai pu avoir accès à suffisamment de décisions pour juger de l’évolution de la jurisprudence en matière d’ordre public familial international durant cette période transitoire. C’est donc sous réserve de confirmation que je présenterais des indicateurs d’une voie empruntée par les quelques rares décisions auxquelles j’ai pu avoir accès, et qui ne révèlent peut-être pas la tendance générale.
Parmi ces rares décisions, celle-ci. La Cour d’appel de Sousse, le 3 mai 2013, qui annule un mariage entre une tunisienne et un italien pour disparité au culte musulman de la femme.
La décision intervient alors que 3 avant projets de constitutions avaient été établis par l’assemblée nationale constituante qui, tout en maintenant l’article premier de la constitution dans sa rédaction de 1959, figeaient son interprétation en faisant de l’islam la religion d’Etat, après qu’un consensus obtenu à l’arraché ait abouti à ne pas inscrire la « Charia » en source de la loi. Quant à la liberté de conscience, elle n’y était pas consacrée, alors qu’y figurait la protection du sacré et de la religion et que le préambule de ces avants projets fondait la constitution sur l’islam.
Il s’agissait en l’espèce d’un mariage célébré en 2010, à Sousse, par devant notaires, entre une tunisienne et un italien, sans que la question du culte n’ait été envisagée, sans exigence de certificat d’islamisation de l’époux, ce qui confirme « l’hypothèse laique » émise par Ali Mezghani.
Le mari demande peu après le divorce par volonté unilatérale ; il l’obtient par application de la loi tunisienne (compétente conformément à la règle de conflit) et, conformément à celle-ci des indemnités sont accordés à la femme.
La femme interjette appel pour demander l’augmentation de ces indemnités. La Cour infirme le jugement de première instance en déclarant « l’action en divorce irrecevable parce qu’il n’y a pas de mariage ; et que les relations sexuelles entre un homme et une femme ne peuvent être qualifiés ni de contrat, encore moins de contrat de mariage, si l’époux n’est pas musulman car parmi les empêchements les plus essentiels et les plus fondamentaux, figurent l’interdiction pour la musulmane d’épouser un non musulman »
Et si la Cour veut bien admettre « que la religion est une question personnelle entre Dieu et sa créature », elle considère que « tous les indices convergent pour considérer l’époux comme non musulman, il s’appelle Giuseppe, est de nationalité italienne et domicilié en Italie » Elle invective alors les notaires qui ont célébré ce mariage « sans s’assurer de la religion de l’époux et sans avoir exigé sa conversion à l’islam, celui-ci étant sans doute chrétien »
C’est donc avec beaucoup de force que l’arrêt revient aux interdits religieux et l’impression qui s’en dégage c’est la remise en cause même du code du statut personnel, plus précisément de sa légitimité. L’arrêt cite bien l’article 5 du code du statut personnel, mais il l’interprète comme renvoyant aux empêchements prévus par le charaa et non par la loi, et s’il cite aussi son deuxième alinéa, il le cite dans sa version ancienne, avant la réforme de 2007 qui avait modifié l’âge minimum du mariage en le fixant à 18 ans pour les hommes et les femmes. Et c’est peut être dans cette omission que le bât blesse le plus, on puise dans le CSP ce qui nous convient, le reste on l’ignore.
L’arrêt ignore l’article 14 qui fixe les empêchements à mariage et n’inclue pas parmi ceux-ci, la disparité au culte musulman. Pourtant, les avants projets qui avaient vu le jour au moment où la décision a été prise avaient tous institué la règle selon laquelle les « dispositions de la présente constitution sont comprises et interprétées comme un tout harmonieux », principe évident en matière d’interprétation, valable pour tous les textes, y compris le code du statut personnel. L’article 5 ne peut être lu détaché de l’article 14, il ne peut être interprété qu’à sa seule lumière puisque c’est l’article 14 qui fixe les empêchements au mariage et que ceux-ci comme toute exception sont d’interprétation stricte.
L’arrêt ignore la jurisprudence et la doctrine tunisienne quand il affirme que l’empêchement au mariage lié à la disparité au culte musulman de la femme fait l’unanimité de la doctrine et des tribunaux.
L’arrêt ignore le seul rattachement autorisé dans le CSP et le Code de droit international privé, à savoir le critère de la nationalité, quand il parle de la femme, il ne la désigne jamais en sa qualité de tunisienne, mais toujours en sa qualité de musulmane.
La Cour d’appel ignore l’égalité entre les sexes dans le libre choix du conjoint, puisqu’aucun empêchement d’ordre religieux ne frappe le mariage des hommes. Et, quand elle affirme que des relations sexuelles entre un homme et une femme peuvent ne pas être qualifiés de contrat, on est saisi d’épouvante. S’il n’est pas un contrat, un acte sexuel est un viol, car il n’y a pas eu consentement de l’une des parties. Dire que des relations sexuelles puissent ne pas faire l’objet d’un contrat, c’est tout simplement donner un permis de violer.
Le viol du code du statut personnel est manifeste. Il y a dans cette décision, comme une volonté d’ébranler les fondements mêmes du code du statut personnel. Et cette volonté on la retrouve dans d’autres décisions. Certains juges ont pris des libertés avec les lois relatives à l’état civil, en particulier celles qui font du mariage un acte solennel dont la validité dépend de l’intervention d’autorités publiques civiles, dans un contexte interne où les mariages coutumiers se multiplient et sont justifiés ou banalisés au nom de leur conformité à la religion, alors qu’ils sont incriminés par la loi pénale. Une décision rendue par le tribunal de première instance de Tunis le 3 mai 2013 fustigée par Monsieur Sami Bostangi qui en fait le commentaire, reconnait ainsi un mariage religieux établi en Italie, entre un tunisien et une marocaine, au motif qu’il avait été inscrit dans les registres d’état civil italiens et dans ceux du consulat de Tunisie en Italie. Et ce, au mépris des textes interdisant une telle reconnaissance et de l’ordre public qui aurait dû sanctionner un mariage contraire aux choix fondamentaux de la Tunisie. Car l’institution d’un mariage solennel à l’indépendance, répond aussi à des exigences de protection des femmes. Il garantit le respect de l’interdiction de la polygamie et du droit de la femme d’obtenir le divorce sur un pied d’égalité avec l’homme. En reconnaissant les mariages coutumiers, on ouvre la voie aux mariages polygamiques et à la possibilité de rupture non judiciaire du mariage, unilatérale, et à la discrétion de l’époux.
L’adoption internationale est toujours impossible, quand bien même la crainte de la traite des enfants aurait pu être écartée par voie de ratification de la convention de la Haye sur l’adoption internationale (1993) qui met en place une coordination entre les Etats signataires permettant de protéger l’enfant contre tout risque d’exploitation. Les enfants en attente d’adoption sont nombreux et l’adoption interne elle-même stigmatisée pour des raisons religieuses est devenue rare, sinon nulle. Selon madame Selma Abida, magistrate exerçant au centre d’études juridiques et judiciaires, il n’y aurait eu aucune décision d’adoption durant cette période transitoire.
La constitution du 26 janvier qui entre en vigueur les jours qui viennent, mettra t elle fin à ce recul constaté des droits de l’homme au profit du référent religieux dans la détermination des choix fondamentaux de l’ordre juridique tunisien ?
Ordre public familial international et constitution du 26 janvier 2014
La liberté de conscience a été consacrée, tout comme l’égalité en droits et en devoirs entre les citoyens et les citoyennes. Leur consécration s’est obtenue à l’arrachée, grâce à la formidable mobilisation de la société civile, à la suite de débats houleux, souvent violents à l’intérieur comme à l’extérieur de l’ANC. Ils ont été consacrés, mais de manière suffisamment vague et ambigüe pour alimenter encore des controverses sur leur interprétation.
L’égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et de toutes les citoyennes est garantie dans le préambule et dans l’article 21 du chapitre relatif aux droits et libertés qui dispose « Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune. L’Etat garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie décente.».
Les articles qui suivent citent l’ensemble des droits et libertés collectifs et individuels, à l’exclusion de ceux relatifs à la famille » Et l’article 46 du même chapitre engage l’Etat à protéger « les droits acquis de la femme, à les soutenir et œuvrer à leur amélioration » S’agit il des droits acquis dans le code du statut personnel, le texte ne le précise pas. Contrairement à la constitution de 1959 qui avait introduit lors de sa révision en 1997, l’exigence de respect par les partis politiques des principes du code du statut personnel (article 8), ceux-ci n’ont pas été constitutionnalisés dans le texte du 26 janvier 2014. S’il est clair que l’égalité dans les droits politiques, économiques, sociaux et culturels sont garantis, sans discrimination de sexe, il n’en est pas de même des droits privés et familiaux. L’égalité dans les relations privées et familiales, entre les hommes et les femmes baigne dans le flou, seuls les droits attachés à leur qualité de citoyenne (droit de vote et d’être éligible, droit au travail, à la santé etc.) sont accordés de manière expresse aux femmes désignées alors en tant que citoyennes. Seul l’article 46 abandonne l’expression de citoyenne pour celle de femme. Mais alors s’il s’agit bien des droits acquis en matière de statut personnel, pourquoi ne pas l’avoir précisé ?
Le flou est d’autant plus présent que des doutes peuvent être émis sur le maintien de la ratification par la Tunisie de la CEDAW. Seuls les principes « nobles » des droits de l’homme sont reconnus dans le préambule. Et certains ne manqueront pas d’ôter toute noblesse à la CEDAW. En mars 2013, le ministre des affaires religieuses n’avait-il pas déclaré que la CEDAW porte atteinte à notre identité arabe et musulmane ?
Pour autant, il sera difficile de remettre en cause la ratification de la CEDAW, et ce, conformément à l’article 20 qui dispose que « les traités internationaux approuvés par l’assemblée représentative et ensuite ratifiés, ont un rang supra législatif et un rang infra constitutionnel ».
L’approbation de la CEDAW avait été faite par la chambre des députés, sous l’ancien régime, donc par une assemblée représentative (encore qu’il est possible de ne lui reconnaitre aucune représentativité), mais la levée des réserves notamment à l’article 16 qui garantit l’égalité dans la famille faite par le gouvernement qui avait précédé ceux mis en place après l’élection de l’ANC, n’a jamais été confirmée par ceux-ci, auprès de l’ONU. Ces réserves pourront d’autant plus être maintenues que seuls les principes des droits de l’homme sont reconnus dans le préambule, on pourra admettre le principe de non discrimination posé par la CEDAW, mais pas toutes ses applications particulières, pas dans la famille.
La famille est l’objet d’une disposition qui figure dans le chapitre des principes généraux, l’article 7 selon lequel: « la famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat doit en assurer la protection »
L’article 6 garantit la liberté de conscience, mais il interdit aussi l’atteinte au sacré et fait de l’Etat le protecteur du sacré et de la religion. Permettre à la tunisienne de jouir pleinement de sa liberté de conscience dans le choix de son conjoint pourra être considéré par certains comme étant une atteinte au sacré. Cellule de base de la société, la famille est garante du maintien de l’identité arabe et musulmane de la Tunisie que plusieurs dispositions du préambule incitent à préserver tout comme d’autres dans le corps même de la constitution l’article 39 sur l’enseignement, en particulier. C’est l’homme qui transmet sa religion à la famille, le mariage de la tunisienne avec un étranger non musulman pourrait être considérée comme une menace à notre identité. Et on pourra invoquer le même argument s’agissant de l’héritage par des étrangers non musulmans de tunisiens musulmans ou de l’adoption de tunisiens par des étrangers non musulmans.
En raison de l’ambiguïté des textes relatifs à l’égalité des hommes et des femmes dans la famille, l’ordre public international qui fait de l’égalité entre les sexes, un choix fondamental de l’ordre juridique tunisien, pourra ne pas être consolidé. Ni consolider l’intérêt de l’enfant, en choix fondamental de l’ordre juridique tunisien. Intérêt sacrifié au nom du respect des prérogatives du père, son tuteur légal, comme l’a souligné Madame Kalthoum Meziou, ou au nom de la préservation de l’identité arabe et musulmane et ce, en matière de garde ou d’adoption. « L’enfance disputée » pour reprendre le titre de la thèse de Souhayma Ben Achour n’a été résolue au profit de l’intérêt de l’enfant qu’une fois sapées les discriminations religieuses et que s’ancrait le principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
Ce dernier principe avait été consacré lors de la mise à l’écart des normes étrangères autorisant la polygamie et la répudiation. La jurisprudence était constante dans son refus de reconnaitre les répudiations prononcées à l’étranger pour leur non-conformité à l’ordre public international, comme dans sa mise à l’écart des normes étrangères autorisant la polygamie au nom du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. Jurisprudence renforcée par l’article 49 du code de droit international privé qui interdisait de célébrer des mariages sans certificat de célibat préalable pour les ressortissants de pays admettant la polygamie et qui n’hésitait pas à puiser le principe d’égalité entre les sexes y compris dans les dispositions de la CEDAW sur lesquelles l’Etat avait fait des réserves et à l’élargir à d’autres domaines que l’interdiction de la polygamie et la répudiation.
Comme cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 21/5/2009. La Cour avait été saisie d’un divorce demandé par la femme tunisienne d’un égyptien domicilié en Egypte. Quoiqu’ayant invoqué l’absence de compétence des tribunaux tunisiens in limine litis, celle-ci est néanmoins retenue par les juges du fonds et la Cour de cassation rejette le pourvoi effectué par l’époux au motif que « même si la femme se rendait en Egypte et qu’elle y obtenait un jugement de divorce, celui-ci ne serait pas reconnu en Tunisie pour sa contrariété à l’ordre public international ». La Cour considère en effet que « si la femme peut obtenir en Egypte, un divorce kholoo (par sa volonté unilatérale), conformément à la loi égyptienne de 2000, elle devrait renoncer à tous ses droits financiers, y compris la dot et que la décision rendue n’y serait pas susceptible de voies de recours. Ce divorce, estime la Cour, est contraire aux choix fondamentaux de la Tunisie qui reposent sur la garantie de la dignité de la femme et de l’égalité entre les sexes, le respect de sa liberté de se marier et de divorcer en bénéficiant du double degré de juridiction ». « Ce sont, ajoute la Cour, les principes fondamentaux de l’ordre juridique tunisien et ce, conformément aux articles 5, 6 et 8 de la constitution et au paragraphe 1/a et b de l’article 16 de la CEDAW. Parce la femme ne peut obtenir un jugement à l’étranger qui puisse être reconnu en Tunisie, les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaitre du divorce. Et, ajoute la Cour, ce sont ces considérations qui fondent la compétence des tribunaux tunisiens et non pas la nationalité tunisienne de la femme, contrairement à ce qui a été décidé par les juges du fond ».
En ce qui concerne la garde qui avait été accordée à la mère, par les juges du fond, la Cour rejette aussi le pourvoi fondé sur le fait que le mari domicilié à l’étranger ne peut surveiller l’éducation de ses enfants et l’existence d’une décision égyptienne la lui accordant. La Cour considère en effet que « la garde a été accordée conformément à l’intérêt de l’enfant contrairement à la décision égyptienne qui ne peut dès lors être reconnue pour sa contrariété à l’ordre public international ».
Si certaines décisions s’étaient opposées aux normes étrangères qui accordaient l’égalité des père et mère dans l’éducation des enfants, l’autorité parentale étant considérée contraire à notre ordre public qui consacre l’autorité paternelle, celle-ci étaient rares. L’arrêt précité de 2009 de la Cour de cassation qui refuse de reconnaitre la décision égyptienne qui accorde la garde des enfants à leur père, opposant à l’autorité paternelle revendiquée parce celui ci, l’intérêt de l’enfant est révélatrice aussi de l’ancrage du principe d’égalité. A l’affirmation des prérogatives du père, on préfère l’intérêt de l’enfant.
Pourra-t-on affirmer avec autant de force que l’égalité est un principe fondateur de l’ordre juridique tunisien et l’opposer aux normes étrangères inégalitaires ou bien la brèche ouverte par le flou des dispositions constitutionnelles concernant l’égalité dans les relations familiales ouvrira-t-elle la voie à un revirement de jurisprudence sur le fondement du référent religieux ?
Malgré le flou des textes, le principe de monogamie et d’égalité dans le divorce devraient pouvoir continuer à nourrir l’ordre public familial international. Malgré le flou des textes régissant le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, toute tentative de réforme au nom du référent religieux, se verra opposer l’article 49 qui interdit toute limite aux droits et libertés touchant à leur essence, or ce sont des institutions par définition inégalitaires. Quand bien même l’égalité dans la famille n’est pas consacrée expressément, celui de l’intérêt supérieur de l’enfant l’est (article 47) et le référent religieux est placé sur un même pied d’égalité que celui des droits de l’homme. Le préambule ne fonde plus la constitution sur la religion, comme c’était le cas dans les avants projets, la fidélité aux enseignements de l’islam est consacrée en même temps que celle due aux principes universels des droits de l’homme.
Toutes les discriminations religieuses qui avaient été établies ont reposé sur le seul article premier de la constitution de 1959 que la jurisprudence et l’administration avaient élevé au rang de règle supra constitutionnelle. Repris dans sa formulation de 1959, il l’est toujours et de manière expresse cette fois ci, mais d’autres dispositions le sont tout autant. L’Etat civil, institué par l’article 2 et qui renvoie à un Etat démocratique, garant des droits et libertés fondamentaux conformément aux dispositions du §3 du préambule, l’est aussi, il ne peut non plus être révisé. Il en est de même des droits et libertés fondamentaux garantis par la constitution (article 49).
Mais il est temps de conclure, et de répondre à la question empruntée à Francescakis « Y a-t-il du nouveau en matière d’ordre public ? » Oui et Non. Oui, car les référents de l’ordre public ont changé, une constitution a pris la place d’une autre. Oui, parce que la constitution nouvelle invite plus que l’ancienne à concilier entre les divers droits et libertés qui y sont consacrés et le référent religieux et à ne pas établir de hiérarchie entre ces différentes valeurs. Non, parce que l’ambiguïté caractéristique de l’ordre public familial international ancien (laïc et religieux à la fois) demeure. Comme autrefois, l’unification de son contenu autour des valeurs des droits de l’homme, ne sera pas un long fleuve tranquille.
Monia Ben Jémia,
Février 2014
Communication présentée vendredi 7 février au colloque qui s'est tenu à la FSJPST, deuxièmes journées Mohamed Charfi de DIP
Tags : Monia Ben J
commenter cet article
0 Commentaires
- Ecrire un commentaire
- Commenter
Les + lus
Les + commentés
18.02.2026
23.11.2025